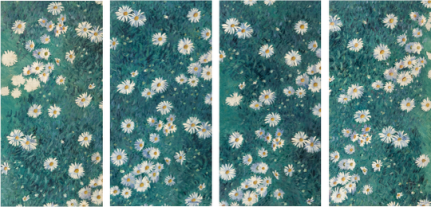Les cris des enfants concurrencent le chant des oiseaux. Nous veillons sur un jardin fantôme. Prenez au fond de la ruelle, nous sommes au bout de la voie : dans un couloir. Certains diraient dans une impasse. Nous choisissons la transhumance.
Une pelouse en façade. Une de plus en alignement de ces petites maisons type ouvrières. Les fenêtres ceinturées de briquettes rouges. Une façade triste, mine grise. Une porte, deux portes plutôt, comme un sas pour rejoindre un jardin de poche à l’arrière, cloisonné par de hauts murs d’écoles. A l’étroit dans des pots, les Jardins de Calipso survivent un peu dans ce rectangle de verdure, emprisonné dans ce grand univers de cours d’écoles bitumées. Les cloches de l’église tellement voisine côtoient-elles l’air débonnaire de chouettes Effraie ? Nous sommes au 15 d’un boulevard, dans un gros bourg mayennais. Village perdu dans une grande plaine où les seigneurs sont les chevaux. Le cheval a ici son panthéon. Les clôtures aux palissades en bois courent sur des kilomètres, formant comme une symétrie axiale aux champs de céréales trop réguliers –où pas un seul épi ne dépasse-champs d’une agriculture conventionnelle qui dessinent ce paysage du haut Maine. C’est ici, dans une bulle remplie d’ennui et d’attentes, que Benoît et moi avons posé quelques valises, plutôt quelques pots.
Les trois carpes Koï sont mortes, cet été sous le soleil brûlant, dans un suicide. La lessiveuse qui leur servait alors de sarcophage se remplit désormais de l’eau de pluie, débordante de vide.
Des cannes noires de Phylostachys se dressent à différentes hauteurs pour barrer un petit potager. Un écran, une clôture inspirée de celle qui forme l’enceinte des jardins du Quai Branly à Paris. Les mésanges charbonnières viennent s’y percher en haut des cimes donnant un léger mouvement de balancier au bambou. Dans cet ilot de verdure emmuré comment faire entrer la Nature entière, toute la biodiversité ?
Un composteur construit avec quatre palettes pourrait bien attirer quelques rongeurs indésirables mais il accueille déjà certainement nombres d’insectes volants ou décomposeurs. Ici la nature morte pour commencer l’entrée de la biodiversité. Puis à l’automne, s’est ensuivi l’installation de nos deux nichoirs à mésanges, très vite visités. La grelinette a refait quelques sorties aussi dès l’automne dernier pour travailler une petite parcelle où engrais verts (trèfle incarnat et seigle) ont été semés. Notre cage a été suspendue devant la fenêtre de la cuisine faisant office une fois de plus de mangeoire avec graines de tournesol et boules de graisse. Cependant, celle-ci proche de la maison n’attire « que » les mésanges et rouge-gorge, familiers. Alors en janvier dernier, j’ai décidé de construire deux nouvelles mangeoires : une format boite à lettres qui se trouve vers le fond du jardin emmuré, la seconde en forme de plateau surmonté d’un toit double pente placée sur un piquet de châtaignier au centre de la pelouse du jardin d’accueil. Quelques heures après leur installation, les deux mangeoires étaient visitées. La Nature sait se faire très vite une place, même dans un si petit espace. Suffit d’un interstice. Nous attendons aujourd’hui toujours la venue des chardonnerets, patiemment. Progressivement après les mésanges, nous avons vu les pinsons des arbres venir évoluer autour des mangeoires et au moment où j’écris ces lignes je peux observer un couple de Verdier qui squatte ! Un couple de rouge-queue a fait depuis peu son apparition, arpentant non pas la mangeoire mais le sol de notre bulle de nature… Désormais le ciel de ce bout de terre, jardin du 15, s’est animé.
Dans ce jardin clos, comment accueillir plus d’insectes auxiliaires ? Par une porte, sans nul doute ! Une porte en chêne vermoulu attendait une seconde vie, gardée précieusement sans trop savoir quoi en faire. Et si d’une porte en vieux chêne nous ouvrions un hôtel… à insectes ? Déclouer les planches, scier. Le tour était joué, ou presque car il m’a fallu glaner quelques palettes par ailleurs. Le plus dur était de nous persuader de l’efficacité d’une telle structure. Après documentation, nous sommes tombés sur un modèle présenté par Terre vivante, celui d’un couple allemand Helga et Hans-Dieter Sachse. Un modèle loin de celui que l’on vous vend une fortune clé en main dans une jardinerie : vous voyez bien celui qui fait joli, qui fait plastique ! D’abord, je pense qu’il faut le fabriquer soi-même avec une certaine connaissance des insectes que l’on peut accueillir. Pour les bourdons, j’ai fait une boite avec un trou d’entrée d’un centimètre de diamètre avec en-dessous une planchette d’envol. La chambre a été remplie de foin. Une autre boite avec des fentes horizontales a été remplie de paille pour les chrysopes. Des briques creuses pour les abeilles solitaires, des pierres au rez-de-chaussée pour des orvets ou lézards, des pommes de pin à l’étage pour les perce-oreilles. Également, des tiges creuses de Sambucus (Sureau) ou de plantes vivaces trouvées sur place tel l’Eupatorium accueilleront peut-être des abeilles. Quant aux rondins de bois percés, ils seront visités par des abeilles et guêpes solitaires, les osmies. Les carabes disposeront de vieilles branches et, de leur côté, les insectes xylophages de vieux bois empilés. Enfin, au centre de notre hôtel, on observera trois petits pots en terre cuite retournés et remplis de foin pour nos amis les forficules !
Dans ce jardin clos, comment s’ouvrir, s’offrir le vol d’un papillon ? Semées au début de printemps graines de phacélie, moutarde blanche, panais et cosmos (Sensation blanc) pointent derrière la basse clôture en treillis soudé. Des milliers de cotylédons dans un unique soupçon… Qui pour soupçonner qu’ici, au bout de rien d’un chemin qui ne mène nulle part sinon à nous, un bout de terre ferait sa part ? Ferait sa part.